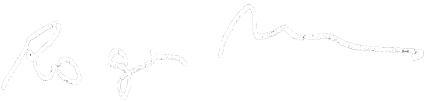Si peu que rien
Carnets 1994/1995 Par Roger Munier
Éditions Les Hauts-Fonds, 2024
Préface par Jacques Munier
« Le peu émeut toujours, dans le monde.
Le peu, le presque rien.
Où le Rien n’est pas encore, seulement s’annonce.
Où le quelque chose est chose à peine, presque rien… »
Le livre que vous tenez entre les mains est la première édition intégrale des carnets où Roger Munier consignait jour après jour ses pensées ou ses notations d’instants. Dans son esprit, ces notes et aphorismes étaient au départ destinés à une publication posthume, même s’il lui est arrivé d’en extraire pour les regrouper par thèmes et les publier en volume. Mais l’éditeur François-Marie Deyrolle avait su le convaincre de les faire paraître sous leur forme initiale, moyennant une sélection parfois drastique. C’est ainsi que furent édités cinq opus au fil du temps, couvrant les années 1980 à 1993 de ses carnets : Opus incertum I. (Deyrolle Éditeur, 1995), La chose et le nom (Fata Morgana, 2001), Opus incertum 1984 – 1986 (Gallimard, 2002), Le su et l’insu (Gallimard, 2005) et Les eaux profondes (Arfuyen, 2007). Le titre générique d’Opus incertum pour l’ensemble de la série – parfois relégué en sous-titre – renvoie à l’ancien vocabulaire du bâtiment, où il désigne « un mode d’agencement des matériaux par assemblage de pierres irrégulières s’enchâssant les unes dans les autres de façon à former un ouvrage continu ». Rien qui ne convienne mieux, selon l’auteur, à l’ensemble dont chacun des moments « pourrait s’entendre comme l’une des pierres d’un tel « opus », isolée et d’importance variable, mais s’inscrivant dans un tout qu’on puisse espérer cohérent dans la masse. La méditation est une. » Quant au titre du présent recueil, « Si peu que rien », il avait été choisi par lui, projeté en note et retrouvé dans les feuillets d’origine.
La publication intégrale produit des effets inattendus. À commencer par un aspect « martelant » : les thèmes directeurs de la pensée de Roger Munier semblent traités comme dans une forge, tournés, retournés, modelés sous la frappe, galvanisés… L’être et l’étant, l’apparence et l’apparition, le temps et l’éternité, Dieu et le Manque, attachement et détachement… Le lecteur pourra suivre les variations subtiles et significatives, souvent marquantes, d’une réflexion au jour le jour comme ici, à la fin juillet 1994, sur la question du néant : « Dire : le néant “est“ est contradictoire dans les termes, sans doute. Mais rien que là. Nous n’avons, touchant le néant, que des problèmes de mots… » Puis le 3 août, trois pensées distinctes sur le même sujet, notées à différents moments de la journée mais témoignant d’une même interrogation qui le poursuit, et presque le hante.
« Le néant, bien sûr, n’a pas de réalité. Rien qu’une prodigieuse irréalité. »
« Au surplus, le néant a un nom – et des plus parlants. Pourquoi le lui a-t-on donné ? »
« Le néant n’“est“ pas, mais il hante tout ce qui est. Privé d’être, au sens propre, il ne peut que “hanter“ ce qui est. »
L’autre effet collatéral de l’édition intégrale provient de la restitution du rythme quotidien, même si les dates n’ont pas été conservées ici pour éviter les lourdeurs dans la mise en page. Mais l’aspect « journal de bord » revient souvent, non sans fluidité. Ainsi de l’orage d’été, ardemment attendu « comme événement et rupture », finalement resté en suspens, empêchant toutefois de « goûter le soir ». Le lendemain, après l’événement survenu au cours de la nuit, « Les restes de l’orage et les premières lueurs de l’aube sont fondus dans le nouveau matin. » Car c’est bien à la première personne que s’écrit cet « opus incertum », comme tout journal. Parfois même l’auteur semble tirer le lecteur par la manche : « Vous lisez avec moi – plutôt que vous ne me lisez. C’est comme si vous écriviez avec moi. » La forme « journal » ajoute un effet de présence, vivante, qui revient à chaque page, se glisse entre les aphorismes plus « philosophiques », anime par intervalles la lecture continue d’un trouble dû à la trace de « la main qui se pose » sur le papier. « Ce que j’écris, ce qui passe à travers moi et m’étonne, lentement m’ôte à moi-même, pour n’être plus que ce qui passe, à travers moi. »
« J’écris pour l’intervalle entre le lecteur et moi – pour ce « milieu » où ce que j’ai tenté́ de dire et ce que le lecteur en fait, autrement, plus parfaitement se prononce. »
Enfin, et comme par effet de capillarité, la lecture conjointe, presque simultanée de fragments plus philosophiques ou au contraire plus poétiques permet de mieux saisir l’élément commun qui les inspire dans la pensée de Roger Munier. « Aborder poétiquement les concepts, les solliciter, comme ébranler… Les concepts ont tous, à des degrés divers, un humus poétique. C’est cet humus que je fouille. » Et il revient à la figure stylistique de « l’instant » de produire au mieux cette « capillarité ». Car l’écriture de l’instant traduirait, selon lui, la langue dans laquelle se livre le monde, « le sourd éveil du monde ». Dans un texte sur le fragment, publié en conclusion de Contre-jour (Atelier La Feugraie) Roger Munier évoque « la belle expression, à la profondeur inaperçue » de « moment donné ». Et la forme qui lui correspond, avec son rythme, son ton quasiment « incantatoire » et son aspect parfois « tremblé », du fait de la hâte qu’impose la notation brève d’un « intense et comme primitif émoi ». Cette figure de l’instant, au double sens du terme qui inclut également la connotation d’ « insistant », est partout présente dans ce recueil, même dans ses parties les plus philosophiques, les plus développées.
« L’instant, quand il se produit, est comme le monde entier rassemblé, précipité là… »
Telle est l’ambition d’ensemble, jour après jour, année après année : capter sans cesse « l’instant évanescent et fulgurant » sous toutes ses formes, pour constituer un « opus » improbable et continu qui puisse rendre compte d’une vision du monde coïncidant avec son constant retrait. L’auteur, dont l’œuvre publiée a débuté par un essai sur l’image (Contre l’image, Gallimard 1963), pourrait faire sienne cette formule d’Henri Cartier-Bresson : « La photographie est un couperet qui dans l’éternité saisit l’instant qui l’a éblouie. » Dans un texte intitulé Photographie (Le Chant second, Deyrolle Éditeur, 1991), Roger Munier rend hommage à Cartier-Bresson en désignant ainsi son art subtil : « toute photo est une surprise, un cadeau qui vient d’ailleurs, une sorte de miracle. Le photographe fait moins l’image qu’elle ne se fait elle-même, en quelque sorte à son insu… » Le paradoxe fait également signe vers une réalité, le « peu de réalité » (A. Breton), à recueillir dans l’instant fugace qui s’ouvre pourtant sur l’éternité. Et pour l’écrivain cette difficulté supplémentaire : « donner la parole au monde avant et plus encore sans qu’ait eu lieu cette intervention du dire. Non de répondre à cette invite, mais de capter l’invite même : la profusion des sens possibles, l’en-deçà de toute parole. » Avantage de la photographie, son caractère énigmatique « ne disant rien de ce qu’elle nous présente, sinon qu’elle nous le présente, elle conserve toute la virtualité de sens du réel. »
« Mince ruisseau dans les prés. Ne pouvoir dire ce qu’on ressent, que pourtant on ressent, à écouter ce bruit perlé de l’eau, sur les pierres et les herbes du fond.
Qu’on peut décrire comme bruit, mais sans pouvoir atteindre ce qu’on ressent, en l’écoutant. Qui est d’avant les mots, et plus : d’un en-deçà des mots… »
C’est donc toute la matière de cette quête éblouie, fascinée, effarée parfois, que nous livrent au quotidien, à la confluence de la poésie et de la pensée, les pierres inégales mais enchâssées de l’Opus incertum. En parallèle à l’œuvre philosophique et critique de Roger Munier, ces carnets illustrent parfaitement sa démarche spéculative : une exploration de notre rapport au monde au plus près de l’expérience, voire en amont d’elle dans le « vertige de l’avant ». Si toute conscience est conscience de quelque chose (Husserl), il tente de remonter le fil de l’intentionnalité pour cerner, en-deçà de la chose perçue, de son « contour », de son « éclat » (Le Contour, l’éclat, réédition aux Éditions des Compagnons, 2023) la pure disposition d’esprit qui conditionne notre attention aux formes. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pour l’auteur, la réponse est dans la question posée par Leibniz, mais elle ne renvoie pas au principe de raison. C’est dans la dimension du « rien » que s’appareille le « contour », dans le hors tout qui définit la chose sur fond de néant et la fait apparaître. « J’habiterai un jour sans voix le désert où j’ai crié… » Pour ceux d’entre nous qui l’ont connu, c’est aussi l’écho d’une voix familière qui nous revient, et nous étreint, dans ce recueil.
« Comment ai-je pu arriver jusqu’à ce jour, cette heure, ce moment ? Avec moi, en continu de moi ? il me semble que je viens de très loin, et même de plus loin que moi.
Je ne finirai pas, pour la raison peut-être que je n’ai jamais vraiment commencé. »